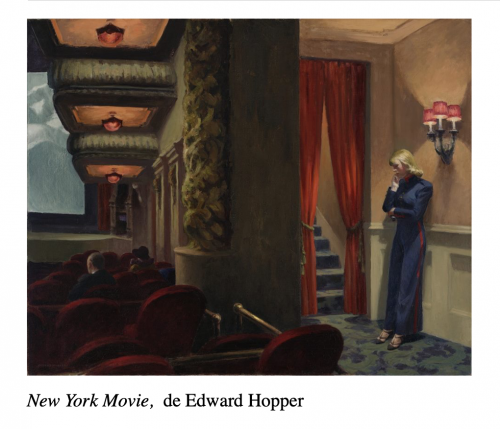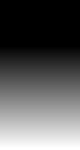Cécile le savait. Il y a quelques semaines,
elle l'avait regardé descendre l'escalier raide qui mène aux combles – celui
qu'elle s'est promis de changer dès qu'elle aura acheté l'appartement – aux
marches découpées à la japonaise, et le voyant ainsi passer d'une marche à
l'autre, par à coups précautionneux, presque vertical, elle s'était dit qu'un
beau jour il finirait par basculer cul par-dessus tête.
Baptiste l'a trouvé ce matin, à son réveil,
gisant au bas de l'escalier, raide déjà. Tenant à moitié debout, la tête
retenue par la partie basse de la rampe. La nuque brisée par sa chute.
Le train de Cécile venait à peine de
quitter la gare d'Aix-en-Provence TGV lorsque son fils lui a appris la nouvelle. Dix appels manqués, elle
s'attendait à quelque chose de grave, et quand elle l'a entendu dire "Je
ne sais pas comment te dire…", elle a pensé stupidement qu'il avait pris sa
voiture et l'avait accidentée, mais c'était autre chose, des mots dont elle
peine à se souvenir, le Chat, nuque, escalier, tout raide. Sur le moment, elle
a interrogé Baptiste, avec ce détachement qu'on a quand on n'a pas encore
réalisé, quand, comment, comprenant de travers, déjà mort, de la pisse par
terre, mis dans la panière à linge, emballé dans des serviettes. Et puis elle a
été incapable de poursuivre, a raccroché pour se mettre à sangloter derrière
son masque, dans l'indifférence générale des passagers. S'est enfuie aux
toilettes pour laisser libre cours à son chagrin, à la peine et au regret de
n'avoir pas pu le revoir, de l'entendre encore ronronner comme un diesel ou
sentir son poids sur ses pieds quand il venait dormir avec elle, pendant la
saison froide surtout – l'été, il préférait dormir dans le jardin et ne
rentrait que pour prendre le frais ou pour manger. En elle, se mélangeaient la
l'incrédulité et la révolte, la douleur et la pensée rationnelle – mieux valait
qu'il soit parti ainsi, plutôt que d'affronter les longues maladies à venir et
la décision d'abréger ses souffrances.
Une part d'elle refusait d'admettre son
absence définitive et s'imaginait le retrouver à son retour, l'entendre la
saluer d'un miaulement sonore avant de s'en aller vaquer à ses propres
occupations, d'un pas de sénateur et la tête altière, dans une souveraine
indifférence envers le devenir des humains. Elle s'est rappelé le temps passé à
l'observer, qu'il dorme, fasse sa toilette ou s'assoie face à elle sur la table
basse du salon, la gratifiant d'un clignement de ses yeux verts avant de
reprendre sa pose hiératique de sphinx. Elle savait déjà combien ce temps-là
allait lui manquer, celui passé à le caresser, à enfouir ses doigts dans sa
fourrure douce et fournie de chat sibérien, à s'apaiser au bruit de son
ronronnement si particulier, qui ne cessait d'étonner ses visiteurs. Elle s'est
demandé ce qu'elle allait faire de ce temps vide. L'automne serait être encore
plus froid et triste sans ce compagnon qui partageait ses nuits.
Incapable de rester en place, elle
s'est installée sur la plateforme près des bagages où elle est restée pendant
les six heures de trajet, à observer les allées et venues des passagers et des
contrôleurs, à engager avec les uns et les autres de courtes conversations. De
quoi se distraire, un peu. Le trajet était long, entrecoupé de divers incidents
– deux passagers sans billets et récalcitrants, un autre pris de folie qui a
agressé des voyageurs, dont une femme qu'il a mordue à la cuisse avant d'être
arrêté par la police venue en renfort à la gare de Dijon – elle a songé à
Baptiste qui avait enveloppé le corps mort et raide et froid, si horriblement
immobile, et l'avait déposé dans la panière à linge pour le descendre à la cave
en attendant son arrivée. Son fils courageux qui a sangloté quand elle l'a
rappelé, racontant combien le Chat avait apprécié le poulet à l'indienne que son
amie et lui lui avaient fait goûter la veille.
Ils ne savaient rien du Chat, ne connaissaient
ni son vrai nom, ni son âge. Cécile présumait qu'il devait avoir une vingtaine
d'années puisqu'à l'époque où elle avait commencé à fréquenter la maison qui allait
devenir la sienne, son compagnon affirmait qu'il avait 15 ans. Ce qui lui
semblait beaucoup, alors qu'il chassait, des oiseaux surtout dont elle
retrouvait les plumes dans le jardin, qu'il dormait dans la fourche d'un des
lauriers et grimpait en haut du bouleau pour qu'on vienne le chercher.
Aujourd'hui, il ne reste plus rien de tout cela – son compagnon est mort, le
bouleau a été abattu.
Elle l'a vu doucement décliner, marcher
de moins en moins vite, boiter parfois. Mais il parvenait encore à grimper dans
le laurier près de la porte d'entrée, à marcher dans la gouttière pour
rejoindre la terrasse où il pouvait passer des heures, allongé au soleil, ou
enroulé sur une chaise de jardin, ou pour gratter à la fenêtre afin qu'on lui
ouvre. Elle croit entendre le crissement de ses griffes sur la vitre ; elle
croit l'entendre miauler et ne peut s'empêcher d'aller jeter un œil, espère
deviner sa silhouette attendant patiemment qu'on lui ouvre. Elle s'attend à
tout moment à le voir laper l'eau croupie des soucoupes de pots de fleurs ou
les gouttes de pluie restées sur la table. Mais la terrasse est vide.
Elle aurait voulu être là, recueillir
son pauvre corps et le coucher dans des linges pour qu'il soit bien, lui
caresser la tête et le rassurer ; elle aurait aimé être avec son fils et lui
éviter de faire ce qui n'était pas de sa responsabilité, et lui épargner cette
première confrontation avec la mort. Quand elle partie pour l'Italie, elle n'a
pas pris le temps de le chercher pour lui faire une dernière caresse. Une
pensée lui vient, de se dire qu'il est mort sans l'avoir revue, et que
peut-être il a pu penser que qu'elle l'avait abandonné. Mon vieux lion fatigué,
se répète-t-elle. Mon chat. Le Chat.
Son fils l'attendait sur le quai. Il
l'a longuement serrée dans ses bras, ils ont pleuré tous les deux. Pleuré
encore lorsqu'ils sont allés à la cave et qu'ils ont une dernière fois mêlé leurs
doigts à sa fourrure – s'il n'y avait sa position, les pattes tendues et
raides, et sa tête rejetée en arrière, la bouche à demi ouverte, et son
immobilité, sa raideur, on aurait presque pu s'attendre à l'entendre ronronner.
Elle lui a parlé, lui a dit au revoir, ils l'ont emballé comme ils pouvaient
dans les serviettes, et Baptiste l'a porté ainsi, dans la panière, avec le bout
de ses pattes et sa fourrure qui dépassaient, jusqu'à la clinique vétérinaire
voisine. Le vétérinaire est parti l'examiner, ils se sont étreints longuement
sous le regard désolé des maîtres de chiens et de chats qui patientaient. Le
Chat était pucé, il s'appelait Chapka et était né en mars 2005. Il avait donc
16 ans et demi ou presque, un âge honorable pour un chat de race dont Cécile
n'avait jamais compris comment on avait pu l'abandonner.
Ils sont repartis avec la panière à
linge vide, se tenant fort l'un contre l'autre, et ont passé beaucoup de temps
à énumérer les souvenirs, riant et pleurant tout à la fois. Cinq ans de
partage, d'agacement et de tendresse.
Cécile passe devant ce coin de la
cuisine où il se ruait pour manger, se rappelle son habitude à venir se frotter
contre la porte du placard quand elle en sortait sa nourriture, comment
l'ouverture d'un yaourt le faisait accourir à toute vitesse, le nombre de
paquets de brioches éventrées par sa gourmandise, ses roucoulements en pleine
nuit pour sortir, son art de se faire une place sur le canapé, bien au milieu,
petit tyran domestique qui lui manque affreusement et qu'elle continue de
pleurer.
Dans
trois semaines, ils enterreront ses cendres dans le coin du jardin où il se
plaisait à s'installer, aux beaux jours. Elle plantera un rosier. Et peut-être,
ensuite, prendront-ils un autre chat. Et même deux.